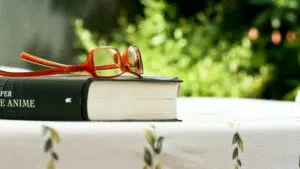Le chiffre est dérangeant : près de 80 % des familles ayant un enfant autiste déclarent faire face à des comportements jugés inadaptés. Derrière ce pourcentage, il y a une réalité complexe, souvent mal comprise, qui bouscule le quotidien et pousse à chercher, parfois dans l’urgence, des réponses concrètes. Si certains facteurs comme la sensibilité sensorielle exacerbée ou les bouleversements de routine sont fréquemment cités, la palette des causes dépasse largement les idées reçues. Pour accompagner au mieux les personnes autistes, il ne s’agit plus seulement de “gérer” mais de comprendre et d’anticiper.
Comprendre les comportements inappropriés en autisme
Quand survient un comportement inadapté chez une personne autiste, la réaction immédiate est souvent la déstabilisation, tant pour elle que pour son entourage. On parle de comportements défis, mais derrière ce terme se cachent des situations très variées, liées à la fois au trouble du neurodéveloppement et à des difficultés de communication ou d’interaction sociale.
L’autisme, tel qu’il a été décrit par Leo Kanner et Hans Asperger dans les années 1940, s’est depuis imposé comme un spectre aux multiples visages. Grâce aux travaux de Lorna Wing, la notion de continuum a permis d’élargir la compréhension des symptômes et de sortir d’une vision unique et figée. Aujourd’hui, la recherche avance, avec des experts comme Thomas Bourgeron et Richard Delorme qui ont mis au jour des gènes associés à l’autisme, tels que SHANK3 et ASMT, ce dernier étant impliqué dans les troubles du sommeil, fréquents dans le spectre.
Des initiatives européennes telles que AIMS-2-Trials et CANDY s’attachent à explorer les multiples dimensions de l’autisme, en quête de mécanismes et d’interventions plus ciblées. Côté terrain, les modèles fonctionnels élaborés par Sprague et Horner, tout comme les typologies d’événements contextuels de Freeman, deviennent des outils précieux pour décrypter et accompagner les comportements défis. La classification de Mc Bien et Felce, elle, permet de mieux cibler et d’ajuster les réponses en fonction des profils individuels.
Les apports de Carr sur les troubles du comportement et le modèle éco-comportemental de Greenwood complètent cette approche, en mettant l’accent sur l’interaction entre l’individu et son environnement. Ce regard croisé favorise des interventions plus fines et adaptées.
Les causes des comportements inappropriés
Les origines des comportements inadaptés chez les personnes autistes relèvent souvent d’un enchevêtrement de facteurs, à la fois internes et externes. Des troubles sensoriels, par exemple, peuvent déclencher des réactions vives face à des bruits, des lumières ou des textures qui passeraient inaperçus pour d’autres. Les difficultés d’expression ou de compréhension, fréquentes dans l’autisme, génèrent régulièrement de la frustration, qui se manifeste parfois par des actes que l’on qualifie rapidement de « défis ».
Les travaux de Sprague et Horner ont montré que ces comportements peuvent être, en réalité, une forme d’expression ou une réponse à un environnement mal ajusté. Le modèle éco-comportemental de Greenwood rappelle combien l’entourage immédiat influe sur ces réactions.
La typologie de Mc Bien et Felce recense, parmi ces comportements, des gestes auto-agressifs, des poussées d’agressivité envers autrui ou encore le pica, c’est-à-dire l’ingestion d’objets non alimentaires. Carr souligne l’intérêt d’adapter l’approche à chaque personne, en tenant compte de son vécu et de ses besoins particuliers.
Les événements contextuels identifiés par Freeman, comme une modification soudaine de la routine ou une ambiance sonore trop intense, peuvent aussi précipiter ces conduites. Voici, pour y voir plus clair, quelques facteurs fréquemment impliqués :
- Les troubles sensoriels
- Les difficultés de communication
- Les changements dans la routine
- Un environnement non adapté
Prendre en compte l’ensemble de ces éléments permet d’orienter l’accompagnement et d’imaginer des réponses à la mesure de chaque situation.
Impact sur la qualité de vie
Les comportements inadaptés ne sont pas de simples incidents isolés : ils laissent des traces sur la vie quotidienne, pour la personne autiste comme pour son entourage. Les observations de Hill, Scheerenberger et Mansell confirment qu’ils réduisent les possibilités d’intégration, d’accès à la scolarité ou à l’emploi, et peuvent entraîner une forme d’isolement social. Pour les familles, la charge émotionnelle et psychologique s’alourdit, impactant parfois l’équilibre du foyer.
La notion de qualité de vie, telle que l’ont formulée Schalock et Bogale, se mesure à la satisfaction ressentie dans les expériences du quotidien. Lorsque les comportements défis s’installent, ce sont les relations, le bien-être émotionnel et la santé qui vacillent. Les recherches de Mc Gill font aussi émerger la question des coûts financiers, avec des dépenses supplémentaires pour l’accompagnement, le suivi médical ou l’adaptation de l’environnement.
| Facteurs Impactés | Conséquences |
|---|---|
| Opportunités sociales | Isolement accru |
| Accès à l’éducation | Retards scolaires |
| Bien-être familial | Détresse psychologique |
| Coûts financiers | Dépenses médicales et éducatives |
Pour Verdugo, la qualité de vie englobe la santé physique, l’équilibre émotionnel, la richesse des relations et le développement personnel. Ces différentes dimensions aident à évaluer l’impact global des comportements défis, et à orienter les interventions pour soutenir au mieux les familles, sur tous les plans.
Solutions et interventions efficaces
Pour agir sur les comportements inadaptés, rien ne remplace des stratégies ciblées, mises en place avec rigueur. Le programme TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) propose une organisation de l’environnement pensée pour répondre aux besoins spécifiques de la personne autiste. Imaginé par Schopler et Mesibov, ce cadre structurant apporte des repères stables, réduit l’incertitude et apaise les tensions liées à l’imprévu.
Interventions comportementales
Les interventions comportementales, inspirées des travaux d’Albin et O’Biren, s’attachent à analyser les causes immédiates des comportements défis. Elles s’appuient sur plusieurs leviers efficaces :
- l’analyse fonctionnelle des comportements,
- l’ajustement de l’environnement,
- la mise en œuvre de stratégies de prévention.
Le modèle fonctionnel de Sprague et Horner insiste sur la nécessité de prendre en compte les contextes sociaux et physiques dans lesquels surgissent ces comportements.
Renforcement positif
Le renforcement positif, concept défendu par Miltenberg, consiste à valoriser systématiquement les comportements appropriés. Récompenser l’adoption de gestes adaptés, c’est augmenter leur fréquence et réduire, en miroir, les comportements défis. Mais l’efficacité repose sur la régularité et la cohérence des encouragements, qui doivent s’inscrire dans la durée.
Traitements pharmacologiques
Face à certaines situations particulièrement complexes, l’option médicamenteuse peut être envisagée. Des recherches sont en cours sur le lithium pour les personnes autistes porteuses d’une mutation du gène SHANK3. Cette piste, encore expérimentale, ouvre des perspectives pour les profils réfractaires aux interventions comportementales classiques.
Combiner ces approches, en les adaptant au profil de chacun, permet non seulement de réduire l’intensité des comportements inadaptés, mais surtout d’ouvrir le champ des possibles pour les personnes autistes et leurs familles. En s’appuyant sur la recherche et le partage d’expériences, il devient possible de transformer des situations de crise en occasions de progrès partagé.